AU BAL DES ACTIFS
Nouvelle "Serf-made-man ? Ou la créativité discutable de Nolan Peskine" d'Alain DamasioInterview d’Alain Damasio
Tout comme les nouvelles de Norbert Merjagnan, Ketty Steward ou luvan, ta nouvelle plante le concept de la Fin du Travail. Et pourtant, dans un monde où chacun dispose d’un revenu de subsistance, le Travail perdure et reste LA manière de se détacher du lot, d’intégrer la nouvelle élite sociale. Le Travail, alpha et oméga des sociétés humaines ?
C’est plutôt la création, la faculté humaine de sortir de ses déterminants biologiques, qui me semble princeps. Le travail restant une modalité seconde, dérivée. Cette faculté à être autre que soi, à sortir de nous des actes ou des œuvres qui n’étaient pas directement « anticipables », déductibles de notre nature chimique. Ce miracle d’un cerveau fait d’une matière qui échappe à la matière et parvient à hoqueter, parfois, des rots de liberté. À mes yeux, le travail n’a longtemps été qu’un pré-requis incontournable de la survie, pour l’espèce, avant de devenir une modalité du désir social en occident, la fiction un peu risible d’une nécessité qui nous donnerait grandeur et noblesse — tandis qu’elle fait sourire un Africain, avec raison. Dans ma nouvelle, ce désir social de distinction, pour reprendre l’intuition de Bourdieu (puisque se distinguer de la masse, du commun, est une stratégie banale de l’élite) se dégage du travail ordinaire tel qu’on le conçoit depuis le dix-neuvième siècle pour porter sur l’acte même de créer, sur ce sommet de la distinction humaine : qui peut créer, qui peut surprendre, innover, sortir de l’attendu, amener l’avantage différentiel ou concurrentiel dans une économie très largement automatisée ? Si l’intelligence artificielle peut suppléer à la plupart des capacités humaines classiques et endosser les métiers qui y correspondent, même relationnels (accueil, aide, guidage, conseil…), comment se distinguer encore, si ce n’est en créant ?
Serf-Made-man est une critique acerbe de la formation-formatage, telle qu’on la retrouve en Ecole de Commerce – ici « Sup de Cré ». Le vrai danger, c’est l’éducation ?
L’Éducation a toujours eu cette ambiguïté foncière : elle est potentiellement le plus beau vecteur d’émancipation imaginable et l’arme la plus simple et la plus directe pour pré-formater des comportements sociaux. L’enjeu de la nouvelle, tirée de ma propre expérience des écoles de commerce où j’ai été (dé)formé est de montrer qu’en s’appuyant sur un élitisme convivial, très motivant, très valorisant (« vous êtes les meilleurs et vous êtes tellement coools »), on tente de faire croire aux jeunes diplômés, « forces vives » du pays, qu’ils sont libres, qu’on a même besoin qu’ils le soient, pour leur bien et le nôtre, et que leur liberté ne s’accomplira le plus complètement possible qu’en épousant les normes implicites de l’autonomie, de l’initiative, du dynamisme entrepreneurial, de la créativité-pour-l’entreprise. C’est très subtil et pas si évident que ça à contrer car de fait, une certaine marge de liberté est bien offerte, mais elle ne l’est qu’en vertu de l’utilisation de cette liberté pour générer de la plus-value pour le système libéral. Un étudiant brillant est celui qui apporte cette plus-value de créativité dans un système hautement mimétique, sur-balisé et concurrentiel. Et il n’existe professionnellement qu’à mesure de cette plus-value. Si bien que l’idéologie du self-made-man, de celui « qui se fait tout seul », bref du héros capitaliste par excellence, est au fond indissociable de celle du serf-made-man : l’esclave qui se fait tout seul, qui s’aliène par lui-même, par cette intériorisation du surmoi capitaliste dans la moindre de ses démarches : de création, de production comme de consommation. C’est le rêve de tout régime de pouvoir moderne : obtenir des citoyens une servitude volontaire, auto-élaborée, une forme d’obéissance enthousiaste et autogérée.
Ton texte, c’est aussi le constat de la récupération permanente des idées et du vivant par l’univers marchand, de la créativité mise en méthodes et process, du culte du système pour l’anti-système. On nage en plein dans l’absurde, non ?
Au contraire, le capitalisme est un système profondément cohérent dans sa matière et ses méthodes, et profondément mutagène, adaptable, métamorphique. C’est sa grande force. Bien sûr, ce qu’il demande à ses agents (les cadres, les dirigeants, les travailleurs, les clients…) est absurde et contradictoire — et ses effets psychologiques, environnementaux et sociaux sont abjects, mais l’objectivité consiste à reconnaître que nous sommes quasiment tous acteurs de ce système, tous rouages, tous producteurs et consommateurs, tous inféodés à la pulsion-argent puisque l’argent est dans ce régime l’opérateur d’une magie, ce qui nous ouvre à peu près tout : pouvoir, loisir, joie, biens, épanouissement, liberté, sécurité… L’argent est la fluidité même, l’huile et l’eau du système, il irrigue, abreuve, perfuse et fait tout circuler. On le boit autant qu’on le sue.
Donc toute idée qui « fait » de l’argent, toute force vive qui crée « de la valeur » sont promptement récupérées et recyclées, mis au profit du système. Tout livre anti-système qui se vend alimente le système économique de l’édition. Toute idée provocante, à contre-courant, stimule et dynamise le système parce qu’elle aura toujours une transcription monétaire possible, une valorisation en terme de connaissance, d’appoint intellectuel voire de mise en œuvre concrète et lucrative. L’argent code, décode et surcode tout dans ce régime, il est le passage obligé, et rien n’équivaut sa fluidité, sauf le langage, son seul vrai concurrent.
Pour en revenir à la nouvelle : quand un régime postcapitaliste comme le nôtre peut et va se débarrasser de la lourdeur du travail automatisable en l’externalisant vers des IA, d’ailleurs assez frustes, ou des robots relationnels (et engranger des bénéfices colossaux en tant que propriétaire des moyens de production), il n’a plus besoin que d’une infime fraction de la population pour optimiser la machine à cash : cette élite, ce sera les créatifs : les créatifs asservis, canalisés, qui jouiront de faire fonctionner ces machines à plein rendement (c’est le cas aujourd’hui déjà).
Avec Serf-Made-Man, on vit de l’intérieur le quotidien des stagiaires-forçats que sont Laszlo, Sayo et Nolan, entre Travail non-stop et collaboration-destruction, puisque nos trois héros sont incités à se désolidariser les uns des autres par leur hiérarchie. Le Travail comme outil de déshumanisation par excellence ?
Depuis l’avènement de l’industrie au 19e siècle, nous faisons partie, malheureusement, des générations pour lesquelles une schize profonde sépare le travail et le fruit de notre travail. Non seulement nous ne sommes plus propriétaires de nos moyens de production, mais pas plus de nos travaux, de nos agendas, de nos modes d’organisation, de nos objectifs ou de nos méthodes. Je dirais qu’une grosse majorité des gens qui travaillent aujourd’hui sont dépossédés du sens de leur travail, du lien entre ce qu’ils font et la signification qu’a ce qu’ils font pour la société. La déshumanisation, pour moi, c’est ça : la perte du lien entre l’activité qu’on accomplit chaque jour, sous contrainte, sans aucune démocratie ni partage, avec des systèmes hiérarchiques ignobles car automatisés voire algorythmés, indirects et vicieux — et le produit de cette activité, qui n’est le plus souvent qu’une façon assez dégueulasse d’extraire de la plus-value sur le consommateur final ou de piéger l’usager du service public, ou encore, plus subtilement, de faire travailler le client à sa propre aliénation (digital labor mais pas seulement). Serait humain un travail dont le produit assure un tissage des liens, alimente une réciprocité sociale ou empuissante ceux qui en bénéficie. L’éducation, le soin, l’art, la culture relèvent généralement de cette humanité. Mais que dire d’un expert-comptable, d’un contrôleur de gestion, d’un banquier, d’un publicitaire, d’un DRH qui optimise les « ressources humaines » ? Ils me semblent que l’essentiel de leur métier consiste à couper l’humain de ce qu’il est.
Le travail n’a cependant pas le monopole de la déshumanisation aujourd’hui, qu’on se rassure. La consommation numérique gérée par les designers de la dépendance, la lecture des news en ligne, le divertissement saturé par une économie intrusive qui phagocyte notre attention, les réseaux sociaux stigmatisants, anxiogènes et cruels, font un excellent boulot aussi là dessus. Sans parler des coupures et des interfaces constantes mises entre nous et les autres, nous et le réel, nous et le monde, qui ne participent guère d’une humanisation joyeuse.
Ta nouvelle est profondément autobiographique – Cf. ton interview par Richard Comballot dans « Clameurs – Portraits Voltés» (La Volte – 2014).
Finalement, près de 30 ans après, ton cri d’alerte reste le même ?
Rien de ce que j’écris n’est profondément autobiographique, non, même si j’ai eu plaisir ici à retrouver des affects de ma jeunesse, par moments, dans cette fiction. Je travaille avec des fragments de mémoire très furtifs, très ténus, je suis quelqu’un qui pense très peu au passé, qui a une exécrable mémoire, globalement — et qui serait donc incapable de faire dans la biographie ou dans l’autofiction. J’aime déformer vers l’imaginaire, opérer par percept, par affect, par concept et articuler ces trois niveaux. Ici, j’étais guidé par cette sensation sublime qu’on a au moment où une idée authentiquement neuve jaillit en soi, où tout à coup, on sent que quelque chose sort de nous, ou plutôt nous traverse du dehors, comme je l’explique dans la nouvelle, vient se prendre dans un filet précaire de chair et de nerfs, de présence subite au monde, et prend forme. Ce moment de haute vie fugitive qui s’appelle créer. Et je voulais montrer comment le capitalisme futur va vouloir, ça aussi, tenter de le récupérer, de le prévoir, de le préparer, de s’en servir au mieux — et comment une partie de cette création, la plus faible, peut effectivement être mise en fiche, faire l’objet d’une méthode, d’une industrialisation — sauf que la noblesse suprême, la beauté réelle, est de pouvoir créer encore hors de cette récupération, d’échapper encore à ça qu’on veut nous siphonner aussi. C’est comme un combat au sein de la création entre ce qui relève juste de la copie maline, dérivée, « variée » et ce qui tient de l’originalité inouïe. Le final de la nouvelle, sur l‘île, que j’ai d’ailleurs écrit à la volée, en déconnectant le cerveau rationnel, est cette épiphanie de Nolan qui enfin touche, brièvement, sa liberté — enfin déjoue l’immense système tentaculaire qu’on a mis en place pour vampiriser ses actes créatifs. Il s’ouvre une porte entre ses deux épaules.
Enfin : tu es l’un des rares auteurs du recueil à offrir, avec ton texte, une issue positive au lecteur, une alternative possible, un peu de lumière. As-tu un mot, un message à faire passer à ceux qui auront lu Serf-Made-Man ?
Je suis quelqu’un de profondément optimiste et vitaliste, qui croit, dans la lignée de Deleuze et Guattari, que dans un système social, dans tout système, aussi terrible soit-il (et le nôtre n’est pas terrible, il est très « lâche » et reste très ouvert, quoiqu’on en dise), les lignes de fuite sont premières. Le système, tout système fuit. Et le capitalisme, pourtant très haut dans la hiérarchie des systèmes endogènes, fuit aussi. Même quand on lit Primo Levi, on se rend compte que dans les camps de la mort, ça fuit aussi, des poches de liberté sourdent, se dilatent, subsistent, des gens s’en sortent, et pas seulement ceux qui s’échappent du camp. La fin du livre est passionnante là dessus, ce moment où Primo Levi parle de ceux qui ont réussi à survivre, à rester vivant dans leurs comportemenys, et en quelque sorte libres, même au cœur d’un camp de concentration, c’est très dérangeant mais très fort ce qu’il dit à ce moment-là.
Le régime capitaliste est transitoire, comme tout régime. Il nous archi-domine depuis deux siècles mais il passera. Nous en viendrons à bout, comme le reste — mais nous n’en viendrons à bout que si l’on sent, à l’intérieur de nous, ce qu’on lui donne, ce qu’on lui offre à travers la pulsion-argent. Je crois que rien ne sera efficace sans qu’on n’interroge très profondément notre rapport à l’argent dans ce régime. Pas seulement le fait de vouloir de l’argent, de vouloir être riche, pas le fait ignoble de l’accumulation obscène des richesses par quelques-uns, mais le caractère métamorphique absolu de l’argent, le fait qu’il convertisse tout en tout : du travail en logement, de la maison en jouissance, du sexe en revenu, des tâches ultrarépétitives en droit de lézarder au soleil, des services en loisirs, de la manipulation pure en richesse, etc. Comprendre ce que ça a changé dans notre économie de désirs, dans notre façon de vivre le désir. Il y a une homogénéité très forte entre l’argent, le numérique et la technologie quotidienne dans laquelle on se pavane et se noie, une congruence de processus, d’affects et de vécu qui fait la force du technocapitalisme actuel.
Là contre, face à ça, des alternatives existent, se font, agissent déjà, on en a chacun une petite part vivante en nous, dans nos façons de nous déconnecter, d’offrir, de partager, de bricoler le système pour le détourner, de travailler aussi. Et ce qui peut nous guider, « faire phare », se joue à mon sens dans notre capacité à retrouver ces affects du don, ce plaisir de donner sans chiffrage, sans compter, de faire sans évaluer ce qu’on fait, d’être dans la générosité et dans le gratuit. Le courage, la force de faire gratuitement, d’offrir sans attendre de retour. Appelons ça de l’amour, si l’on entend par là un amour vaste, social, pour l’étranger, pour le pas-comme-nous — pas cet amour évident pour notre femme et nos gosses, pour ceux qui nous ressemblent, pour nos amis — même si c’est important et déjà pas si facile !
C’est ça ce que ce système nous a pris, et qu’il a remplacé par une sorte de mesquinerie généralisée et comptable, dont on ne mesure plus à quel point elle nous traverse et nous structure. L’empire du chiffrée, du numérique, de l’escompté, est partout : on n’y répondra que par le don, le sans-prix, le partage, le bénévolat, toutes ces choses que le régime capitaliste déteste et méprise précisément parce qu’il y sent la menace d’un monde qui finira par le détruire.
Ces courants alternatifs existent et prennent du poids aujourd’hui, même dans le monde numérique, même au cœur de ce monde de la trace, du big data et de l’attention préemptée. Ils ont pleins de noms et déploient une myriade de pratiques qui en font la fécondité, jamais parfaites, mais on s’en fout car ça vit : copyleft, creative commons, logiciels libres, le retour des Communs, le Share, les fablabs, les hackerspaces, les jardins partagés, la mutualisation, les SEL, le théâtre-forum, les squats, les prix libres, le financement contributif, les ZAD, l’éducation populaire, l’autoconstruction, l’économie de partage, toute une pratique militante que je trouve très intelligente, très mature, qui s’affranchit des hiérarchies anciennes et des gourous, fonctionne à l’horizontalité et au dissensus.
Pour trouver un peu de lumière, il suffit souvent de lever la tête et de s’orienter dans la direction du soleil, planqué derrière leurs clouds. La crise n’est qu’une production délibérée du capital, un outil de plus à son service, qu’il a inventé et qu’il chérit comme on couve des œufs de serpent. Tout comme la tristesse et le pessimisme qu’on nous vend à longueur de livres et d’actualité restent les opérateurs parfaits de tous les pouvoirs pour continuer à nous aliéner et à obtenir de nous l’obéissance dont ils se délectent. Sachons y opposer un peu de gniaque et de joie brute, un peu de puissance directe là où l’on habite et vit, et un brin d’amour hors cercle, cet amour qui dissout le capital et ses chiffrages, parce qu’il n’est que l’autre nom d’une générosité dans notre présence au monde qui rend tout calcul dérisoire. L’anthropologie nous rappelle que le don et le contredon étaient à la base du lien humain. Le capitalisme, comme le travail-trepalium qui le nourrit et sans lequel il n’est rien, va passer. Ce qui vient, c’est l’opéra et ses opus, l’œuvre et ses œuvriers, toute la famille étymologique qui y correspond, à savoir une conception du travail qui va redonner à la création, artisanale, physique, locale et intellectuelle, toute sa splendeur.
C’est ce que fait entrevoir brièvement ma nouvelle en épilogue. Il y faudra à mon sens le revenu universel, qui seul peut rompre le chantage odieux qui nous cloue tous au sol : « travaillez, citoyens, sinon vous ne méritez que la misère ». Il faut couper ce lien stupide entre revenu et mérite : la richesse de nos sociétés vient de millénaires de progrès scientifiques dont nous sommes tous les héritiers bienheureux et devons tous être les bénéficiaires sans exclusive. La productivité des machines n’a pas à être accaparée mais distribuée. Que ceux qui ensuite veulent continuer à jouer ce jeu social du travail et de la distinction par l’argent le fassent, laissons leur cette infantilisme — mais qu’on cesse d’imposer ce chantage à ceux qui savent se contenter de l’essentiel et vivre en épicurien intelligent. Partout où ce revenu de base a été mis en place, on constate que pour ceux qui en bénéficie, le travail devient activité et œuvre, apport social, développement personnel et entraide naturelle. On retrouve une société qui respire et peut s’ouvrir à l’autre, prendre le temps de l’écoute et de l’échange, plutôt que d’exacerber une compétition qui ne profite qu’à une infime minorité.
Notre conception du travail depuis deux cent ans est pauvre et triste. Encore une fois, prenons conscience qu’elle n’est et ne fut qu’un moment dans l’histoire, qu’il est temps de dépasser. Retrouvons les vertus de l’otium que Sénèque considérait comme la caractéristique de l’homme vraiment libre, face au negotium qui a voulu nous boucher tout horizon.
– Propos recueillis par Anne Adam



Tout comme les nouvelles de Norbert Merjagnan, Ketty Steward ou luvan, ta nouvelle plante le concept de la Fin du Travail. Et pourtant, dans un monde où chacun dispose d’un revenu de subsistance, le Travail perdure et reste LA manière de se détacher du lot, d’intégrer la nouvelle élite sociale. Le Travail, alpha et oméga des sociétés humaines ?
C’est plutôt la création, la faculté humaine de sortir de ses déterminants biologiques, qui me semble princeps. Le travail restant une modalité seconde, dérivée. Cette faculté à être autre que soi, à sortir de nous des actes ou des œuvres qui n’étaient pas directement « anticipables », déductibles de notre nature chimique. Ce miracle d’un cerveau fait d’une matière qui échappe à la matière et parvient à hoqueter, parfois, des rots de liberté. À mes yeux, le travail n’a longtemps été qu’un pré-requis incontournable de la survie, pour l’espèce, avant de devenir une modalité du désir social en occident, la fiction un peu risible d’une nécessité qui nous donnerait grandeur et noblesse — tandis qu’elle fait sourire un Africain, avec raison. Dans ma nouvelle, ce désir social de distinction, pour reprendre l’intuition de Bourdieu (puisque se distinguer de la masse, du commun, est une stratégie banale de l’élite) se dégage du travail ordinaire tel qu’on le conçoit depuis le dix-neuvième siècle pour porter sur l’acte même de créer, sur ce sommet de la distinction humaine : qui peut créer, qui peut surprendre, innover, sortir de l’attendu, amener l’avantage différentiel ou concurrentiel dans une économie très largement automatisée ? Si l’intelligence artificielle peut suppléer à la plupart des capacités humaines classiques et endosser les métiers qui y correspondent, même relationnels (accueil, aide, guidage, conseil…), comment se distinguer encore, si ce n’est en créant ?
Serf-Made-man est une critique acerbe de la formation-formatage, telle qu’on la retrouve en Ecole de Commerce – ici « Sup de Cré ». Le vrai danger, c’est l’éducation ?
L’Éducation a toujours eu cette ambiguïté foncière : elle est potentiellement le plus beau vecteur d’émancipation imaginable et l’arme la plus simple et la plus directe pour pré-formater des comportements sociaux. L’enjeu de la nouvelle, tirée de ma propre expérience des écoles de commerce où j’ai été (dé)formé est de montrer qu’en s’appuyant sur un élitisme convivial, très motivant, très valorisant (« vous êtes les meilleurs et vous êtes tellement coools »), on tente de faire croire aux jeunes diplômés, « forces vives » du pays, qu’ils sont libres, qu’on a même besoin qu’ils le soient, pour leur bien et le nôtre, et que leur liberté ne s’accomplira le plus complètement possible qu’en épousant les normes implicites de l’autonomie, de l’initiative, du dynamisme entrepreneurial, de la créativité-pour-l’entreprise. C’est très subtil et pas si évident que ça à contrer car de fait, une certaine marge de liberté est bien offerte, mais elle ne l’est qu’en vertu de l’utilisation de cette liberté pour générer de la plus-value pour le système libéral. Un étudiant brillant est celui qui apporte cette plus-value de créativité dans un système hautement mimétique, sur-balisé et concurrentiel. Et il n’existe professionnellement qu’à mesure de cette plus-value. Si bien que l’idéologie du self-made-man, de celui « qui se fait tout seul », bref du héros capitaliste par excellence, est au fond indissociable de celle du serf-made-man : l’esclave qui se fait tout seul, qui s’aliène par lui-même, par cette intériorisation du surmoi capitaliste dans la moindre de ses démarches : de création, de production comme de consommation. C’est le rêve de tout régime de pouvoir moderne : obtenir des citoyens une servitude volontaire, auto-élaborée, une forme d’obéissance enthousiaste et autogérée.
Ton texte, c’est aussi le constat de la récupération permanente des idées et du vivant par l’univers marchand, de la créativité mise en méthodes et process, du culte du système pour l’anti-système. On nage en plein dans l’absurde, non ?
Au contraire, le capitalisme est un système profondément cohérent dans sa matière et ses méthodes, et profondément mutagène, adaptable, métamorphique. C’est sa grande force. Bien sûr, ce qu’il demande à ses agents (les cadres, les dirigeants, les travailleurs, les clients…) est absurde et contradictoire — et ses effets psychologiques, environnementaux et sociaux sont abjects, mais l’objectivité consiste à reconnaître que nous sommes quasiment tous acteurs de ce système, tous rouages, tous producteurs et consommateurs, tous inféodés à la pulsion-argent puisque l’argent est dans ce régime l’opérateur d’une magie, ce qui nous ouvre à peu près tout : pouvoir, loisir, joie, biens, épanouissement, liberté, sécurité… L’argent est la fluidité même, l’huile et l’eau du système, il irrigue, abreuve, perfuse et fait tout circuler. On le boit autant qu’on le sue.
Donc toute idée qui « fait » de l’argent, toute force vive qui crée « de la valeur » sont promptement récupérées et recyclées, mis au profit du système. Tout livre anti-système qui se vend alimente le système économique de l’édition. Toute idée provocante, à contre-courant, stimule et dynamise le système parce qu’elle aura toujours une transcription monétaire possible, une valorisation en terme de connaissance, d’appoint intellectuel voire de mise en œuvre concrète et lucrative. L’argent code, décode et surcode tout dans ce régime, il est le passage obligé, et rien n’équivaut sa fluidité, sauf le langage, son seul vrai concurrent.
Pour en revenir à la nouvelle : quand un régime postcapitaliste comme le nôtre peut et va se débarrasser de la lourdeur du travail automatisable en l’externalisant vers des IA, d’ailleurs assez frustes, ou des robots relationnels (et engranger des bénéfices colossaux en tant que propriétaire des moyens de production), il n’a plus besoin que d’une infime fraction de la population pour optimiser la machine à cash : cette élite, ce sera les créatifs : les créatifs asservis, canalisés, qui jouiront de faire fonctionner ces machines à plein rendement (c’est le cas aujourd’hui déjà).
Avec Serf-Made-Man, on vit de l’intérieur le quotidien des stagiaires-forçats que sont Laszlo, Sayo et Nolan, entre Travail non-stop et collaboration-destruction, puisque nos trois héros sont incités à se désolidariser les uns des autres par leur hiérarchie. Le Travail comme outil de déshumanisation par excellence ?
Depuis l’avènement de l’industrie au 19e siècle, nous faisons partie, malheureusement, des générations pour lesquelles une schize profonde sépare le travail et le fruit de notre travail. Non seulement nous ne sommes plus propriétaires de nos moyens de production, mais pas plus de nos travaux, de nos agendas, de nos modes d’organisation, de nos objectifs ou de nos méthodes. Je dirais qu’une grosse majorité des gens qui travaillent aujourd’hui sont dépossédés du sens de leur travail, du lien entre ce qu’ils font et la signification qu’a ce qu’ils font pour la société. La déshumanisation, pour moi, c’est ça : la perte du lien entre l’activité qu’on accomplit chaque jour, sous contrainte, sans aucune démocratie ni partage, avec des systèmes hiérarchiques ignobles car automatisés voire algorythmés, indirects et vicieux — et le produit de cette activité, qui n’est le plus souvent qu’une façon assez dégueulasse d’extraire de la plus-value sur le consommateur final ou de piéger l’usager du service public, ou encore, plus subtilement, de faire travailler le client à sa propre aliénation (digital labor mais pas seulement). Serait humain un travail dont le produit assure un tissage des liens, alimente une réciprocité sociale ou empuissante ceux qui en bénéficie. L’éducation, le soin, l’art, la culture relèvent généralement de cette humanité. Mais que dire d’un expert-comptable, d’un contrôleur de gestion, d’un banquier, d’un publicitaire, d’un DRH qui optimise les « ressources humaines » ? Ils me semblent que l’essentiel de leur métier consiste à couper l’humain de ce qu’il est.
Le travail n’a cependant pas le monopole de la déshumanisation aujourd’hui, qu’on se rassure. La consommation numérique gérée par les designers de la dépendance, la lecture des news en ligne, le divertissement saturé par une économie intrusive qui phagocyte notre attention, les réseaux sociaux stigmatisants, anxiogènes et cruels, font un excellent boulot aussi là dessus. Sans parler des coupures et des interfaces constantes mises entre nous et les autres, nous et le réel, nous et le monde, qui ne participent guère d’une humanisation joyeuse.
Ta nouvelle est profondément autobiographique – Cf. ton interview par Richard Comballot dans « Clameurs – Portraits Voltés» (La Volte – 2014).
Finalement, près de 30 ans après, ton cri d’alerte reste le même ?
Rien de ce que j’écris n’est profondément autobiographique, non, même si j’ai eu plaisir ici à retrouver des affects de ma jeunesse, par moments, dans cette fiction. Je travaille avec des fragments de mémoire très furtifs, très ténus, je suis quelqu’un qui pense très peu au passé, qui a une exécrable mémoire, globalement — et qui serait donc incapable de faire dans la biographie ou dans l’autofiction. J’aime déformer vers l’imaginaire, opérer par percept, par affect, par concept et articuler ces trois niveaux. Ici, j’étais guidé par cette sensation sublime qu’on a au moment où une idée authentiquement neuve jaillit en soi, où tout à coup, on sent que quelque chose sort de nous, ou plutôt nous traverse du dehors, comme je l’explique dans la nouvelle, vient se prendre dans un filet précaire de chair et de nerfs, de présence subite au monde, et prend forme. Ce moment de haute vie fugitive qui s’appelle créer. Et je voulais montrer comment le capitalisme futur va vouloir, ça aussi, tenter de le récupérer, de le prévoir, de le préparer, de s’en servir au mieux — et comment une partie de cette création, la plus faible, peut effectivement être mise en fiche, faire l’objet d’une méthode, d’une industrialisation — sauf que la noblesse suprême, la beauté réelle, est de pouvoir créer encore hors de cette récupération, d’échapper encore à ça qu’on veut nous siphonner aussi. C’est comme un combat au sein de la création entre ce qui relève juste de la copie maline, dérivée, « variée » et ce qui tient de l’originalité inouïe. Le final de la nouvelle, sur l‘île, que j’ai d’ailleurs écrit à la volée, en déconnectant le cerveau rationnel, est cette épiphanie de Nolan qui enfin touche, brièvement, sa liberté — enfin déjoue l’immense système tentaculaire qu’on a mis en place pour vampiriser ses actes créatifs. Il s’ouvre une porte entre ses deux épaules.
Enfin : tu es l’un des rares auteurs du recueil à offrir, avec ton texte, une issue positive au lecteur, une alternative possible, un peu de lumière. As-tu un mot, un message à faire passer à ceux qui auront lu Serf-Made-Man ?
Je suis quelqu’un de profondément optimiste et vitaliste, qui croit, dans la lignée de Deleuze et Guattari, que dans un système social, dans tout système, aussi terrible soit-il (et le nôtre n’est pas terrible, il est très « lâche » et reste très ouvert, quoiqu’on en dise), les lignes de fuite sont premières. Le système, tout système fuit. Et le capitalisme, pourtant très haut dans la hiérarchie des systèmes endogènes, fuit aussi. Même quand on lit Primo Levi, on se rend compte que dans les camps de la mort, ça fuit aussi, des poches de liberté sourdent, se dilatent, subsistent, des gens s’en sortent, et pas seulement ceux qui s’échappent du camp. La fin du livre est passionnante là dessus, ce moment où Primo Levi parle de ceux qui ont réussi à survivre, à rester vivant dans leurs comportemenys, et en quelque sorte libres, même au cœur d’un camp de concentration, c’est très dérangeant mais très fort ce qu’il dit à ce moment-là.
Le régime capitaliste est transitoire, comme tout régime. Il nous archi-domine depuis deux siècles mais il passera. Nous en viendrons à bout, comme le reste — mais nous n’en viendrons à bout que si l’on sent, à l’intérieur de nous, ce qu’on lui donne, ce qu’on lui offre à travers la pulsion-argent. Je crois que rien ne sera efficace sans qu’on n’interroge très profondément notre rapport à l’argent dans ce régime. Pas seulement le fait de vouloir de l’argent, de vouloir être riche, pas le fait ignoble de l’accumulation obscène des richesses par quelques-uns, mais le caractère métamorphique absolu de l’argent, le fait qu’il convertisse tout en tout : du travail en logement, de la maison en jouissance, du sexe en revenu, des tâches ultrarépétitives en droit de lézarder au soleil, des services en loisirs, de la manipulation pure en richesse, etc. Comprendre ce que ça a changé dans notre économie de désirs, dans notre façon de vivre le désir. Il y a une homogénéité très forte entre l’argent, le numérique et la technologie quotidienne dans laquelle on se pavane et se noie, une congruence de processus, d’affects et de vécu qui fait la force du technocapitalisme actuel.
Là contre, face à ça, des alternatives existent, se font, agissent déjà, on en a chacun une petite part vivante en nous, dans nos façons de nous déconnecter, d’offrir, de partager, de bricoler le système pour le détourner, de travailler aussi. Et ce qui peut nous guider, « faire phare », se joue à mon sens dans notre capacité à retrouver ces affects du don, ce plaisir de donner sans chiffrage, sans compter, de faire sans évaluer ce qu’on fait, d’être dans la générosité et dans le gratuit. Le courage, la force de faire gratuitement, d’offrir sans attendre de retour. Appelons ça de l’amour, si l’on entend par là un amour vaste, social, pour l’étranger, pour le pas-comme-nous — pas cet amour évident pour notre femme et nos gosses, pour ceux qui nous ressemblent, pour nos amis — même si c’est important et déjà pas si facile !
C’est ça ce que ce système nous a pris, et qu’il a remplacé par une sorte de mesquinerie généralisée et comptable, dont on ne mesure plus à quel point elle nous traverse et nous structure. L’empire du chiffrée, du numérique, de l’escompté, est partout : on n’y répondra que par le don, le sans-prix, le partage, le bénévolat, toutes ces choses que le régime capitaliste déteste et méprise précisément parce qu’il y sent la menace d’un monde qui finira par le détruire.
Ces courants alternatifs existent et prennent du poids aujourd’hui, même dans le monde numérique, même au cœur de ce monde de la trace, du big data et de l’attention préemptée. Ils ont pleins de noms et déploient une myriade de pratiques qui en font la fécondité, jamais parfaites, mais on s’en fout car ça vit : copyleft, creative commons, logiciels libres, le retour des Communs, le Share, les fablabs, les hackerspaces, les jardins partagés, la mutualisation, les SEL, le théâtre-forum, les squats, les prix libres, le financement contributif, les ZAD, l’éducation populaire, l’autoconstruction, l’économie de partage, toute une pratique militante que je trouve très intelligente, très mature, qui s’affranchit des hiérarchies anciennes et des gourous, fonctionne à l’horizontalité et au dissensus.
Pour trouver un peu de lumière, il suffit souvent de lever la tête et de s’orienter dans la direction du soleil, planqué derrière leurs clouds. La crise n’est qu’une production délibérée du capital, un outil de plus à son service, qu’il a inventé et qu’il chérit comme on couve des œufs de serpent. Tout comme la tristesse et le pessimisme qu’on nous vend à longueur de livres et d’actualité restent les opérateurs parfaits de tous les pouvoirs pour continuer à nous aliéner et à obtenir de nous l’obéissance dont ils se délectent. Sachons y opposer un peu de gniaque et de joie brute, un peu de puissance directe là où l’on habite et vit, et un brin d’amour hors cercle, cet amour qui dissout le capital et ses chiffrages, parce qu’il n’est que l’autre nom d’une générosité dans notre présence au monde qui rend tout calcul dérisoire. L’anthropologie nous rappelle que le don et le contredon étaient à la base du lien humain. Le capitalisme, comme le travail-trepalium qui le nourrit et sans lequel il n’est rien, va passer. Ce qui vient, c’est l’opéra et ses opus, l’œuvre et ses œuvriers, toute la famille étymologique qui y correspond, à savoir une conception du travail qui va redonner à la création, artisanale, physique, locale et intellectuelle, toute sa splendeur.
C’est ce que fait entrevoir brièvement ma nouvelle en épilogue. Il y faudra à mon sens le revenu universel, qui seul peut rompre le chantage odieux qui nous cloue tous au sol : « travaillez, citoyens, sinon vous ne méritez que la misère ». Il faut couper ce lien stupide entre revenu et mérite : la richesse de nos sociétés vient de millénaires de progrès scientifiques dont nous sommes tous les héritiers bienheureux et devons tous être les bénéficiaires sans exclusive. La productivité des machines n’a pas à être accaparée mais distribuée. Que ceux qui ensuite veulent continuer à jouer ce jeu social du travail et de la distinction par l’argent le fassent, laissons leur cette infantilisme — mais qu’on cesse d’imposer ce chantage à ceux qui savent se contenter de l’essentiel et vivre en épicurien intelligent. Partout où ce revenu de base a été mis en place, on constate que pour ceux qui en bénéficie, le travail devient activité et œuvre, apport social, développement personnel et entraide naturelle. On retrouve une société qui respire et peut s’ouvrir à l’autre, prendre le temps de l’écoute et de l’échange, plutôt que d’exacerber une compétition qui ne profite qu’à une infime minorité.
Notre conception du travail depuis deux cent ans est pauvre et triste. Encore une fois, prenons conscience qu’elle n’est et ne fut qu’un moment dans l’histoire, qu’il est temps de dépasser. Retrouvons les vertus de l’otium que Sénèque considérait comme la caractéristique de l’homme vraiment libre, face au negotium qui a voulu nous boucher tout horizon.
– Propos recueillis par Anne Adam



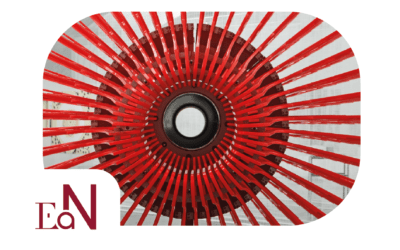
![COLLOQUE – LA VOLTE : VINGT ANS D’ÉDITION À CONTREVENT [11 et 12 juin 2024]](https://lavolte.net/wp-content/uploads/colloque-volte-1-400x250.webp)



0 commentaires